Pour illustrer ce post, j’ai trouvé ce Philosophe en méditation de Salomon Koninck (1609-1656), autrefois attribué à Rembrandt. Les philosophes d’aujourd’hui ne lui ressemblent guère, ni probablement ceux d’autrefois, mais l’image est belle.
Au sommaire de ce PhiloX :
Savoir de quoi on parle (pour éviter de dire n’importe quoi)
L’amour de la sagesse (une première définition de la philosophie)
Philosophes et savants (sont-ils les mêmes ou pas les mêmes ?)
L’acte de naissance de la philosophie (avec Hésiode comme guest-star)
En attendant le prochain PhiloX (quelques brèves pour terminer)
Savoir de quoi on parle
De quoi parlons-nous quand nous parlons de philosophie ? La première chose à faire est de la définir, c’est-à-dire, littéralement, de mettre une limite, une clôture, une frontière entre la chose qu’on désigne et tout ce qu’elle n’est pas. Si on parle de la philosophie au sens large ou de la philosophie dans un sens plus étroit, la clôture ne sera pas au même endroit.
Sans définition, la philosophie pourrait être n’importe quoi.
Or le n’importe quoi existe, quand, par exemple, la philosophie devient une marque de cosmétiques…
…ou quand elle sert à vendre des vêtements sous une couverture vaguement écologiste…
…ou quand on fait croire qu’elle est tellement facile qu’il suffit de 30 secondes pour la maîtriser.
Il faut l’acte violent, tranchant de la définition pour sortir de la confusion.
Alors, qu’est-ce que la philosophie? Comme elle existe depuis au moins 2500 ans et qu’elle s’est transformée au cours du temps, une seule définition ne suffira pas. Commençons par celle-ci.
L’amour de la sagesse
L’étymologie nous renseigne: le verbe phileo signifie aimer d’amitié, et sophia désigne la sagesse. Le philosophe se présente comme un ami de la sagesse et non comme un sage. Il aime la sagesse et il la recherche, parce qu’il ne la possède pas encore.
Mais qu’est-ce que la sagesse? On a envie de répondre que la sagesse consiste à prendre les bonnes décisions dans une situation donnée, quand plusieurs options sont offertes. Ou à découvrir une option nouvelle quand les disponibles ne sont pas suffisantes. Le sage sait laquelle choisir, et il le fait en connaissance de cause. Il sait de quoi il retourne, il est au courant, il a fait des recherches, il a analysé les options, le pour et le contre, et il est parvenu à une conclusion : voici le bon choix, l’option à retenir, la chose à faire.
On ne recherche pas la sagesse pour elle-même. La sagesse veut une morale, elle vise la pratique. À quoi bon la science pour la science, la sagesse pour la sagesse, si cela ne nous permet pas de vivre mieux? On veut être sage pour bien agir et pour parvenir, si possible, au bonheur.
Bref, si vous êtes philosophe, vous aimez la sagesse, vous la désirez, vous voulez la posséder pour vivre heureux — et vous ne pouvez pas être un ignorant, car la sagesse a besoin de connaissances pour s’exercer.
Le sage est donc aussi quelqu’un qui sait, qui dispose de connaissances, mais pas n’importe lesquelles. Voici le début de la définition de la philosophie selon le Grand Robert.
Les savoirs qui ne sont pas rationnels sont légion:
les opinions que je n’ai jamais mises en question
toutes les choses que j’ai apprises par le biais d’une autorité (les enseignants, les lois, la presse, les influenceurs, mes parents, mes amis, tous ceux et toutes celles à qui j’ai fait spontanément confiance)
les enseignements religieux, fondés sur des récits, des mythes, des textes qui se présentent comme une révélation de Dieu ou des dieux.
La plupart des choses que je sais, que je crois ou que je tiens pour vraies, je les ai reçues des autres, sans les soumettre à un examen rationnel. Et heureusement qu’il en est ainsi, car sinon je m’épuiserais dans un travail impossible, et il faut bien vivre, même dans l’imperfection. Mais si je suis philosophe et même si, sans chercher à le devenir, je suis une personne responsable, j’ai besoin de science, de connaissances acquises au moyen de la raison, ou authentifiées par elle. Je ne veux pas être un misologue, quelqu’un qui hait la raison, le contraire d’un philosophe. Je cherche la vérité, je veux des connaissances vraies.
Philosophes et savants
Pendant longtemps, on n’a pas fait de différence entre les philosophes et les savants. Jusqu’à Newton, les mêmes personnes s’occupaient de tout, de la connaissance de la nature, de l’homme, de Dieu, de la morale. Quelques exemples:
Aristote (né en 384 et mort en 322 avant J.-C) s’est occupé de philosophie première, de rhétorique, de logique, d’éthique, de politique, et a jeté les bases de la biologie et de la physique
Galilée (1564-1642) a revendiqué le statut de philosophe, alors que ses recherches sont éminemment scientifiques (mathématiques, géométrie, astronomie, physique)
Descartes (1596-1650) s’est fait un nom en mathématiques et en physique, et pas seulement en philosophie
Pascal (1623-1662) n’est pas seulement l’auteur des Pensées : il a mis au point la première machine à calculer fonctionnelle, a fait des recherches sur la pression atmosphérique et sur le calcul des probabilités, a donné son nom à une unité en physique et à un langage de programmation
Leibniz (1646-1716) a marqué aussi bien l’histoire de la philosophie que l’histoire des sciences
Newton, lui aussi était philosophe, et même un alchimiste passionné.
Aujourd’hui, on fait clairement la différence entre les philosophes et les scientifiques. À chacun son domaine, ses approches et ses méthodes. On peut étudier la philosophie sans se former dans une science, et on n’exige pas de formation philosophique pour les scientifiques. Les scientifiques apprennent l’état le plus récent de leur domaine et n’ont pas besoin d’en connaître l’histoire. Ils se spécialisent, testent leurs hypothèses avec la méthode expérimentale et se font connaître par leurs publications dans des revues.
Que reste-t-il de l’ancien domaine de la philosophie, dont les sciences se sont réparti les morceaux? Une phrase entendue durant mes études disait que la philosophie est le savoir qui n’est pas encore science — comme s’il fallait s’attendre à ce que, bientôt, il ne reste plus rien en propre à la philosophie.
Mais le philosophe moderne est un chercheur d’un genre nouveau. Connaître des objets, c’est la tâche des scientifiques. Le philosophe fait un travail très différent. La citation suivante permet de discerner les contours d’une nouvelle définition de la philosophie.
Pas plus qu’il ne développe des opinions (même les siennes, même raisonnables), pas plus qu’il ne maîtrise une région d’objets, un philosophe ne construit de théories; il dévoile ses cartes sur le tapis, jette son coup de dés, avance une pièce sur l’échiquier – il met en jeu un concept, qui, nouveau, crée soudain une situation neuve, qui redéfinit les réseaux de la rationalité et où apparaissent de nouvelles données, ou plutôt, où les nouvelles données mises en jeu délivrent des donnés nouveaux. Ce que lance un philosophe éclaire tout le champ rationnel d’une nouvelle lumière, voire même y fait apparaître ce que, auparavant, personne n’avait jamais vu. Il se peut même que parfois lui reste obscur ce qu’il éclaire vraiment (…) Aussi on conçoit qu’il n’y ait aucun sens à réfuter une philosophie (…) En effet, réfuter une philosophie consiste la plupart du temps à ne pas la lire ni la connaître, ou parfois à la connaître pour ne pas la comprendre. Car on ne réfute que des savoirs d’objets, voire des opinions et des doctrines, mais pas de nouvelles conditions fixées à la mise en évidence.
Jean-Luc Marion (né en 1946), La Métaphysique et après, Grasset, 2023, pp. 34-35.
La philosophie d’aujourd’hui n’annule pas la philosophie du passé.
Le cabinet du philosophe est tel l’atelier du mécanicien et les œuvres majeures sont les indispensables outils qu’il lui faut toujours avoir à portée de main. Quand le mécano cherche une clé de douze pour examiner le système d’allumage, le philosophe se met en quête de la troisième section du traité De l’Âme d’Aristote pour s’interroger sur l’intellection. Qu’en dit le Stagirite? Et pareillement avec Augustin, Kant, Heidegger ou saint Thomas, Descartes, Husserl: qu’en ont-ils dit? C’est pourquoi ce ne sont point des auteurs que l’on lit une fois pour toutes, mais que l’on relit mille et une fois. Et c’est aussi en cela que nous sommes tous des héritiers.
Jean-Luc Marion, À vrai dire. Une conversation. Entretiens avec Paul-François Paoli, Les Éditions du Cerf, Paris, 2021.
Les grands philosophes apparus depuis le schisme d’avec la science sont des explorateurs du réel, comme le sont, dans un registre très différent, les artistes majeurs. Pour l’art aussi, celui d’aujourd’hui n’annule pas celui du passé.
L’acte de naissance de la philosophie
Reste une question : quelle est l’origine de la philosophie? A-t-elle été inventée d’un coup, un beau jour, par quelqu’un qui aurait été le Premier Philosophe ?
La philosophie est née en Grèce, au VIIe siècle avant Jésus-Christ, deux siècles avant Socrate et Platon, en se détachant peu à peu de la religion.
Les mythes fondateurs de la religion grecque disent que le ciel, la terre, la mer, les montagnes sont des divinités avant d’être des réalités matérielles. Les dieux et la nature sont inextricablement mêlés, comme l’écrit André Bonnard dans son livre sur Les Dieux de la Grèce
Le monde est peuplé de dieux.
Il n’y a pas d’astre au ciel, pas de cime solaire ou de désert de sable, pas d’abîme sous-marin que ne visite la race des dieux.
Il n’y a pas de vide dans le monde, pas de matière creuse de vie. Les dieux partout présents ne font qu’un avec le ciel, la terre et l’eau — avec la Loi qui régit les êtres et les choses.
En toute portion de l’espace, en toute minute du temps, l’homme oublieux et raisonnable heurte soudain cette vie obscure qui limite la sienne et qui l’emplit.
Les dieux le protègent; ils le perdent. Ils sont la vie et la mort.
En face des dieux: l’homme. Les dieux sont le Destin de l’homme.
Hésiode, né vers la fin du VIIIe siècle av. J.-C dans un endroit pauvre de Béotie, se représentait certainement le monde de cette manière. Paysan, il a fait paître ses troupeaux sur le mont Hélicon, mais il a aussi écrit deux grands poèmes, Les Travaux et les Jours, et la Théogonie. Si le cœur vous en dit, vous pouvez lire le premier ici et le second ici.
Dans le prologue de la Théogonie, il demande aux Muses, filles de Zeus et de Mnémosyne (Mémoire), de lui donner « des chants dignes de plaire », car elles lui ont confié la mission de raconter la généalogie des dieux et l’origine du monde. En voici le début.
Donc, avant tout, naquit Abîme (Chaos) ; puis Terre aux larges flancs, assise sûre à jamais offerte à tous les vivants, et le Tartare brumeux, tout au fond de la terre aux larges routes, et Amour, le plus beau parmi les dieux immortels, celui qui rompt les membres et qui, dans la poitrine de tout dieu comme de tout homme, dompte le cœur et le sage vouloir.
D'Abîme naquirent Érèbe et la noire Nuit. Et de Nuit, à leur tour, sortirent Éther et Lumière du jour. Terre, elle, d'abord enfanta un être égal à elle-même, capable de la couvrir tout entière, Ciel étoilé, qui devait offrir aux dieux bienheureux une assise sûre à jamais. Elle mit aussi au monde les hautes montagnes, plaisant séjour des déesses, les Nymphes, habitantes des monts vallonnés. Elle enfanta aussi la Mer inféconde aux furieux gonflements, Flot — sans l'aide du tendre amour. Mais ensuite, des embrassements du Ciel, elle enfanta Océan aux tourbillons profonds, Coios, Crios, Hypérion, Japet, Théia, Rhéia, Thémis et Mnémosyne, Phoibé, couronnée d'or, et l'aimable Téthys. Le plus jeune après eux, vint au monde Cronos, le dieu aux pensers fourbes, le plus redoutable de tous ses enfants ; et Cronos prit en haine son père florissant.
Hésiode, Théogonie, v. 116-138, traduction Mazon.
Je ne vais pas entrer en matière sur les divinités mentionnées, ni sur l'étrangeté de ce récit où la naissance des dieux fait surgir l’univers. Je veux souligner quelques points qui montrent comment Hésiode opère ici un premier glissement de la théologie vers ce qui sera bientôt la philosophie.
Voici comment.
Il y a d’abord le surgissement, l’apparition ou l’émergence de Chaos, gouffre sombre et indistinct, de la Terre (Gaïa), du Tartare au fond de la Terre, et d’Amour (Éros).
Vient ensuite un engendrement par ségrégation. Chaos produit Érèbe (dieu des ténèbres) et sa sœur Nuit. Nuit produit à son tour Éther (partie supérieure du ciel) et Lumière du jour (Héméra). Gaïa enfante, toujours par ségrégation, « sans l’aide du tendre Amour », le Ciel (Ouranos), les montagnes et la mer.
Troisièmement, Amour-Éros intervient et l’union de deux opposés va donner naissance à de nouvelles entités. L’union d’Ouranos et de Gaïa fait naître Océan, Cronos (le temps) et de nombreuses autres divinités, dont la muse Mnémosyne, l’inspiratrice d’Hésiode.
La Théogonie met de l’ordre dans la mythologie à l’aide de ces trois notions : le surgissement, la ségrégation et l’attraction/union de deux éléments distincts. Cette mise en ordre de la mythologie à l’aide de notions (qui ne sont pas encore des concepts à proprement parler) est la première attestation d’une attitude philosophique. Les premiers philosophes véritables s’en souviendront. Mais Hésiode est fondamentalement poète et théologien.
Si la philosophie pointe le bout de son nez chez Hésiode, il faudra attendre au moins deux siècles pour qu’elle parvienne à son épanouissement avec Platon, puis Aristote.
En attendant le prochain PhiloX
Après m’être replongé dans la mythologie grecque pour vous parler d’Hésiode, j’avoue mon admiration pour le récit biblique de la création, tellement plus sobre, plus précis, plus clair. Le monde, l’univers, l’homme, les êtres vivants sont créés par Dieu, mais distincts de lui. La création reflète la gloire de Dieu, mais n’est pas Dieu. La nature n’est pas divine. Quelle libération!
Ce qui ne nous donne nullement le droit de saccager la création, de la mettre en coupe réglée et de la détruire.
Peut-on vivre sans philosophie ?
Les avis sont partagés. Voici ceux de Descartes, de Pascal et de saint Paul. Descartes est convaincu que ce n’est pas possible.
C'est proprement avoir les yeux fermés, sans tâcher jamais de les ouvrir, que de vivre sans philosopher; et le plaisir de voir toutes les choses que notre vue découvre n'est point comparable à la satisfaction que donne la connaissance de celles qu'on trouve par la philosophie; et, enfin, cette étude est plus nécessaire pour régler nos mœurs et nous conduire en cette vie, que n'est l'usage de nos yeux pour guider nos pas. Les bêtes brutes, qui n'ont que leur corps à conserver, s'occupent continuellement à chercher de quoi le nourrir; mais les hommes, dont la principale partie est l'esprit, devraient employer leurs principaux soins à la recherche de la sagesse, qui en est la vraie nourriture; et je m'assure aussi qu'il y en a plusieurs qui n'y manqueraient pas, s'ils avaient espérance d'y réussir, et qu'ils sussent combien ils en sont capables.
Descartes, Lettre-préface des Principes de philosophie.
Pascal n’est pas du tout de cet avis. Dans ses Pensées, il a ce mot sévère sur Descartes, qu’il juge inutile et incertain, et il va jusqu’à affirmer ceci:
Nous n’estimons pas que toute la philosophie vaille une heure de peine.
Pascal, Pensées, fragment 79 (éd. Brunschvicg)
Si tel est votre avis, désabonnez-vous de PhiloX sans tarder. Mais attention, dans le manuscrit des Pensées, ce texte… est barré.
Peut-être Pascal se référait-il à l’avertissement de l’apôtre Paul dans sa lettre aux Colossiens:
Faites attention: que personne ne vous prenne au piège par la philosophie, par des tromperies sans fondement qui s'appuient sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires qui régissent le monde, et non sur le Christ.
Colossiens 2.8
Je vous donne ces trois citations pour avoir dit quelque chose de la philosophie comme piège potentiel, car j’avais annoncé que j’aborderais cette question dans ce post. Nous aurons l’occasion d’y revenir en détail à l’avenir.
L’athéisme chez les prix Nobel
Le psychiatre et écrivain Iain McGilchrist, dans une vidéo sur YouTube (en anglais), donne une statistique du nombre d’athées chez les lauréats du prix Nobel ou ayant reçu une distinction équivalente:
35% chez les spécialistes des humanities (écrivains, poètes, philosophes, historiens, critiques)
9,1% chez les biologistes
4,6% chez les physiciens.
Il affirme aussi que beaucoup de gens ne croient pas en Dieu parce qu’on ne leur a pas donné l’occasion de se forger une compréhension correcte de Dieu. Ils en ont une idée simpliste et négative, alors que, par ailleurs, ils refusent presque tous une vision réductionniste et matérialiste du monde: ils ont compris que nous ne pouvons pas tout savoir, pensent qu’il doit y avoir « quelque chose » derrière tout ça, mais sans savoir comment nommer ce « quelque chose ».
Dédicaces
Je participerai samedi 14 juin au quatrième salon du livre au Château de Cressier. N’hésitez pas à venir découvrir la richesse de la création littéraire dans la région des Trois-Lacs.







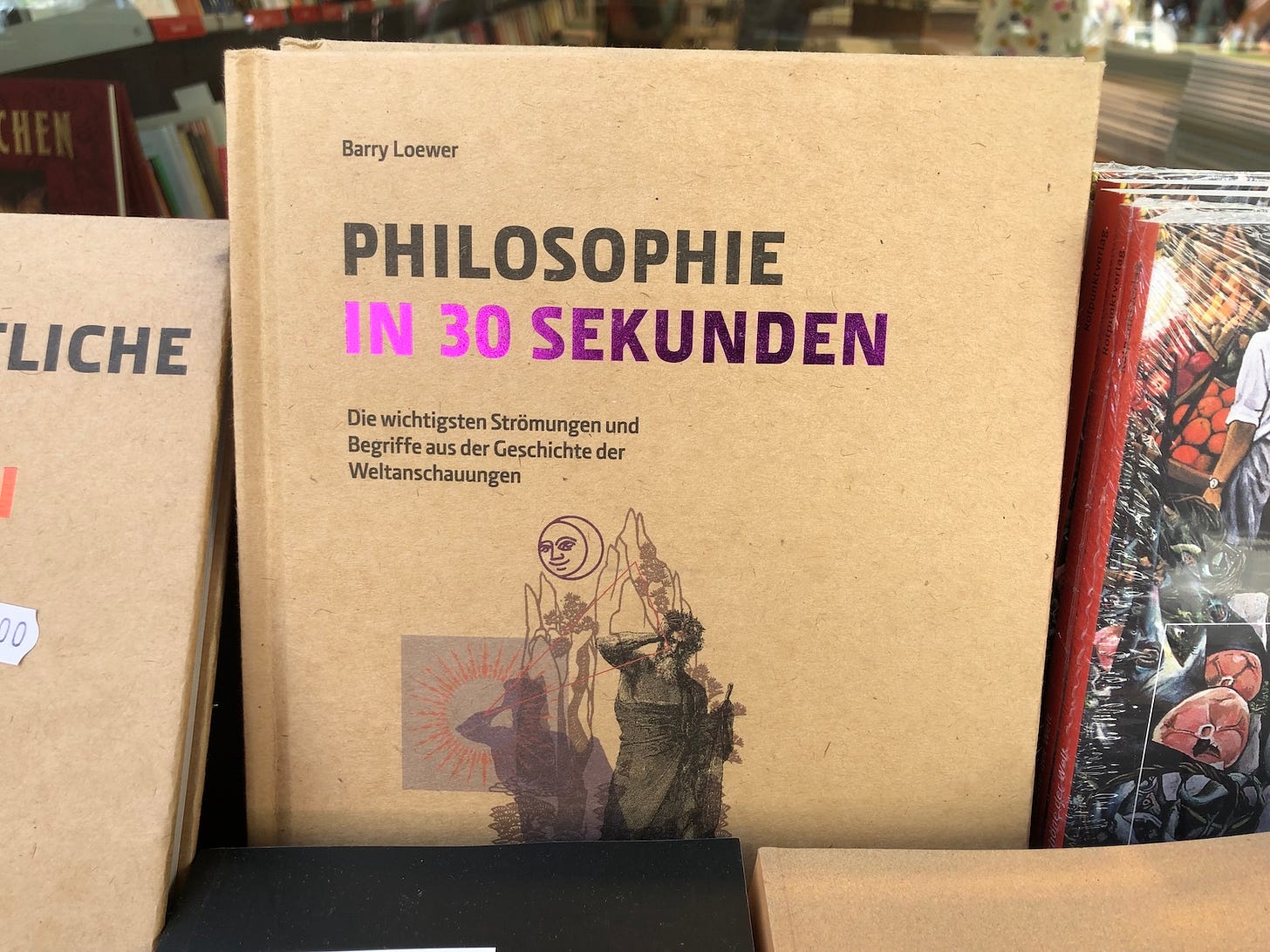
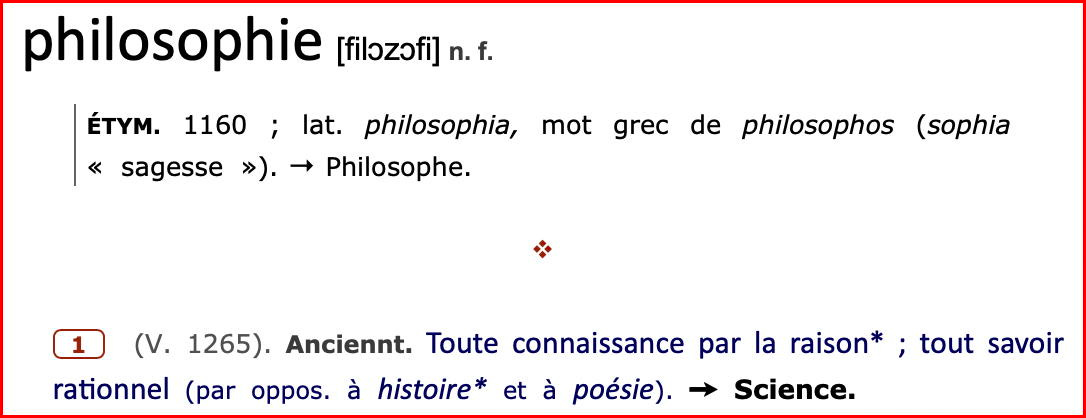


Si l’intelligence d’un propos se mesurait à sa clarté, celui-ci serait brillant!
Bien qu’il soit scientifiquement étayé, il répond à une notion formulée dans « L’art poétique » de Nicolas Boileau :
« Ce qui se conçoit bien s’énonce clairement
Et les mots pour le dire arrivent aisément. »
Avec cette paire d’alexandrins, je me réjouis de la suite…
Merci pour ce partage, très instructif et étayé à souhait par de belles citations.
Jopi